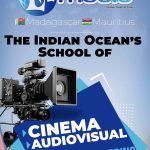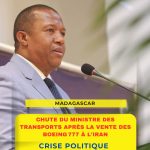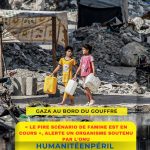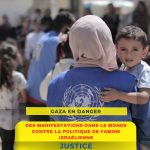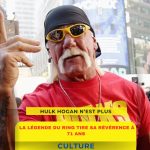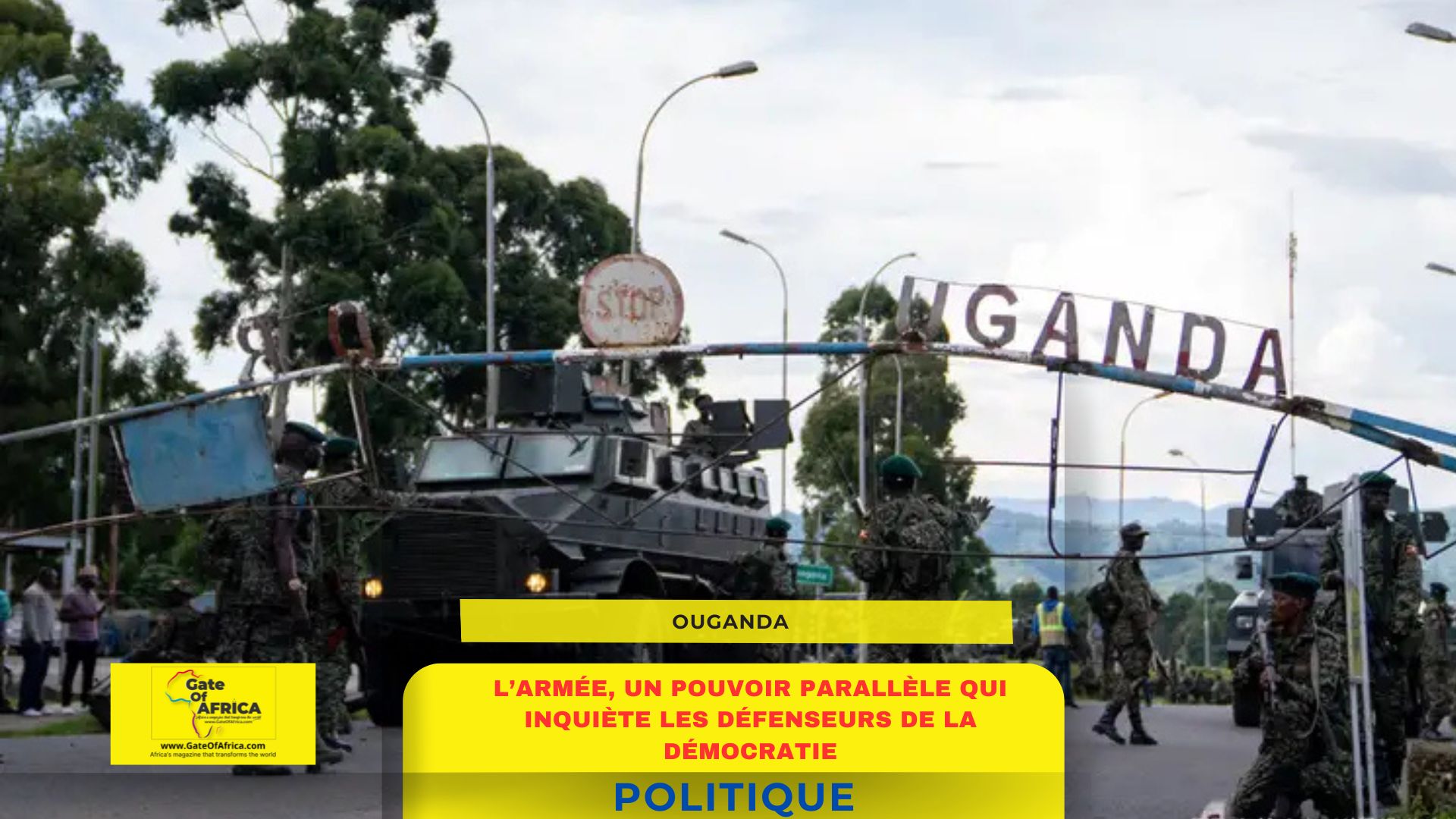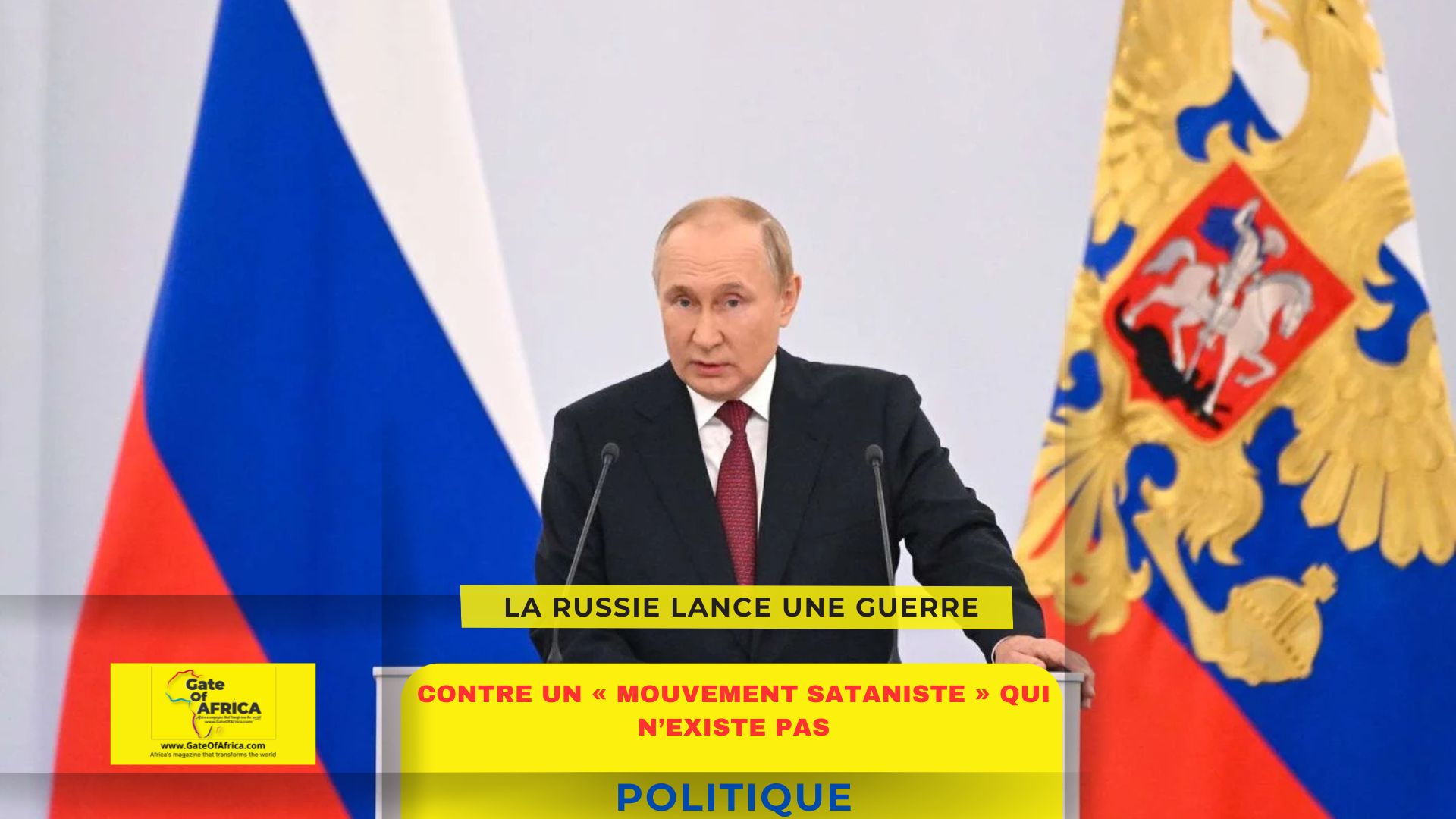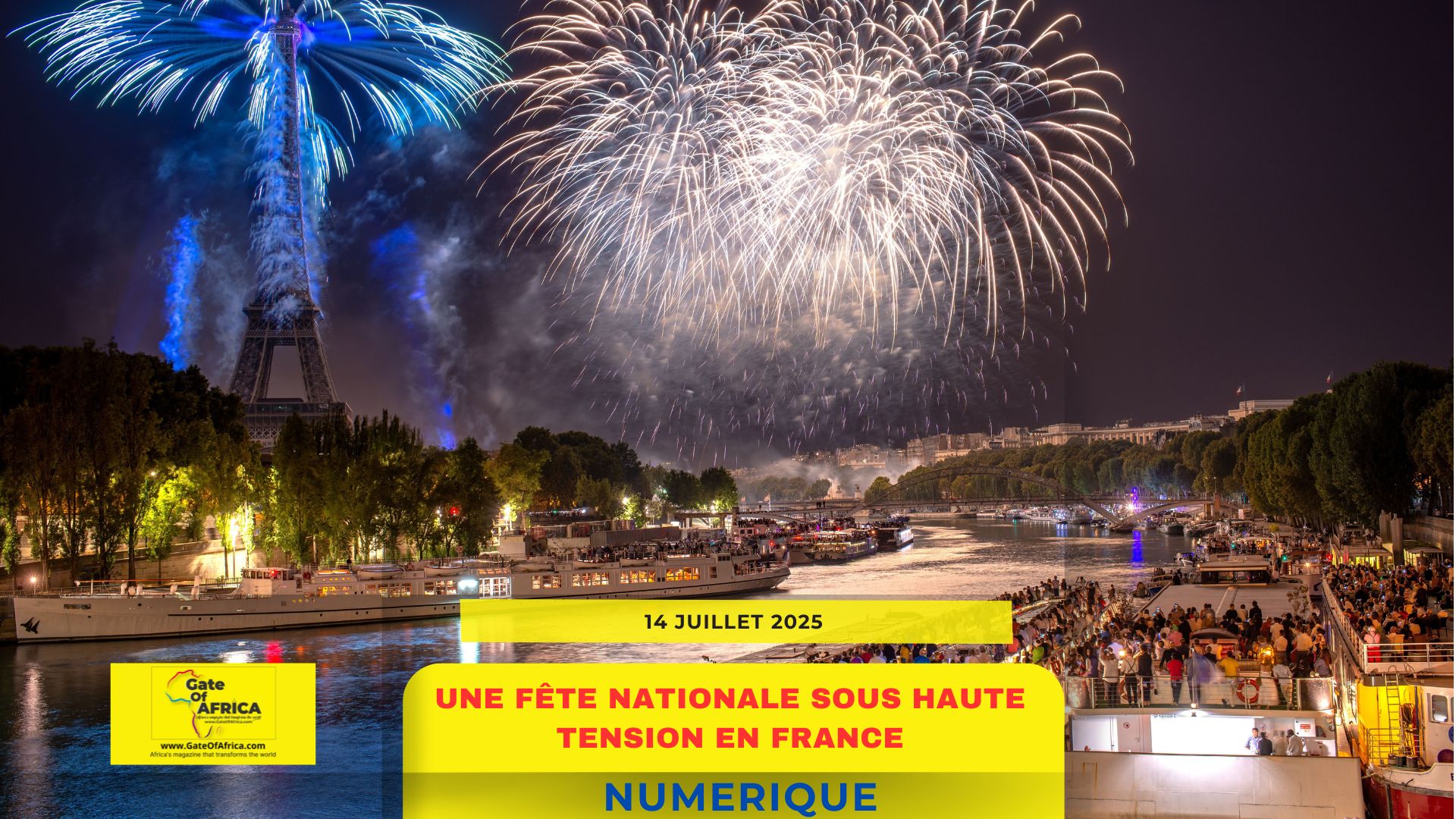Chapeau
Un rapport indépendant publié le 14 juillet par le Centre pour la Gouvernance et la Sécurité de Kampala sonne l’alarme : l’armée ougandaise, historiquement influente, serait en train de renforcer sa mainmise sur l’appareil d’État, affaiblissant les institutions civiles et menaçant la démocratie déjà fragile du pays. Une dérive autoritaire se dessine, à l’approche de l’élection présidentielle de 2026.
Corps de l’article
.Une institution omniprésente
Le rapport de 68 pages, intitulé « Militarisation silencieuse du pouvoir civil en Ouganda », dresse un constat alarmant : l’armée, UPDF (Uganda People’s Defence Force), ne se contente plus d’un rôle sécuritaire. Elle est présente dans les ministères, les entreprises publiques, les médias d’État, et même dans l’organisation des élections.
Plus de 37 hauts gradés occupent actuellement des postes stratégiques civils, certains sans formation adéquate dans leurs domaines respectifs.
« On ne distingue plus le civil du militaire, et c’est précisément là que le danger commence », avertit l’analyste politique ougandais Nicholas Kiggundu.
.Museveni et la culture de la loyauté militaire
Au pouvoir depuis 1986, le président Yoweri Museveni a bâti son régime sur l’allégeance de l’armée, issue de la guérilla du NRA (National Resistance Army). Son fils, Muhoozi Kainerugaba, général influent et désormais conseiller spécial du président, est souvent cité comme successeur potentiel.
Cette proximité familiale et politique renforce l’idée d’un État militarisé par héritage dynastique, où la succession ne se ferait plus dans les urnes, mais dans les casernes.
.Une démocratie sous surveillance
L’Ouganda se targue d’avoir des élections régulières, mais les dernières présidentielles de 2021, qui ont vu Bobi Wine durement réprimé, ont montré le rôle actif de l’armée dans la répression des opposants et la surveillance numérique des citoyens.
Le rapport évoque également :
- Des milices paramilitaires pro-régime dans les zones rurales,
- L’intimidation des journalistes couvrant les questions militaires,
- Une loi sur la cybersécurité donnant à l’armée le pouvoir d’intervenir sur les réseaux sociaux.
. Réactions mitigées de la communauté internationale
L’Union africaine et les Nations unies ont exprimé leur préoccupation, mais sans mesures concrètes. Les États-Unis, alliés sécuritaires de Kampala dans la lutte antiterroriste en Somalie, restent diplomatiquement prudents.
Seules quelques ONG, comme Human Rights Watch et Civic Space Watch Africa, appellent à une enquête indépendante sur l’usage croissant de la force militaire dans les affaires civiles.
Vérification des sources
- Rapport du Centre pour la Gouvernance et la Sécurité de Kampala, édition du 14 juillet 2025.
- Témoignages croisés d’anciens députés et journalistes ougandais exilés (via The Continent).
- Déclarations publiques de Bobi Wine (National Unity Platform) et de Muhoozi Kainerugaba en avril et mai 2025.
Encadré / citation mise en valeur
« Quand les armes entrent dans les institutions civiles, la démocratie en sort affaiblie. » — extrait du rapport, p. 11.
Conclusion
L’Ouganda fait face à un dilemme fondamental : peut-on construire une démocratie stable sur une structure militaire dominante ? Alors que la présidentielle de 2026 s’annonce tendue, la communauté internationale et les défenseurs des droits humains devront surveiller de près ce pays stratégique de la région des Grands Lacs.
La militarisation rampante pourrait bien être le plus grand défi institutionnel de l’ère post-Museveni.
Djayns – Gate Of Africa Magazine
Suivez-nous sur Facebook : Gate Of Africa Magazine
#Ouganda #DémocratieEnDanger #Militarisation #Museveni #UPDF #AfriqueDeLEst #AfriquePolitique #GateOfAfricaMagazine