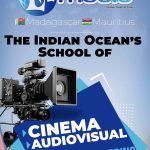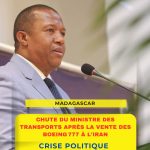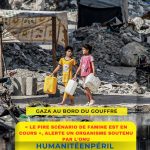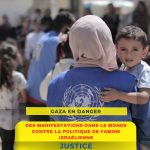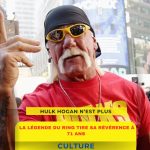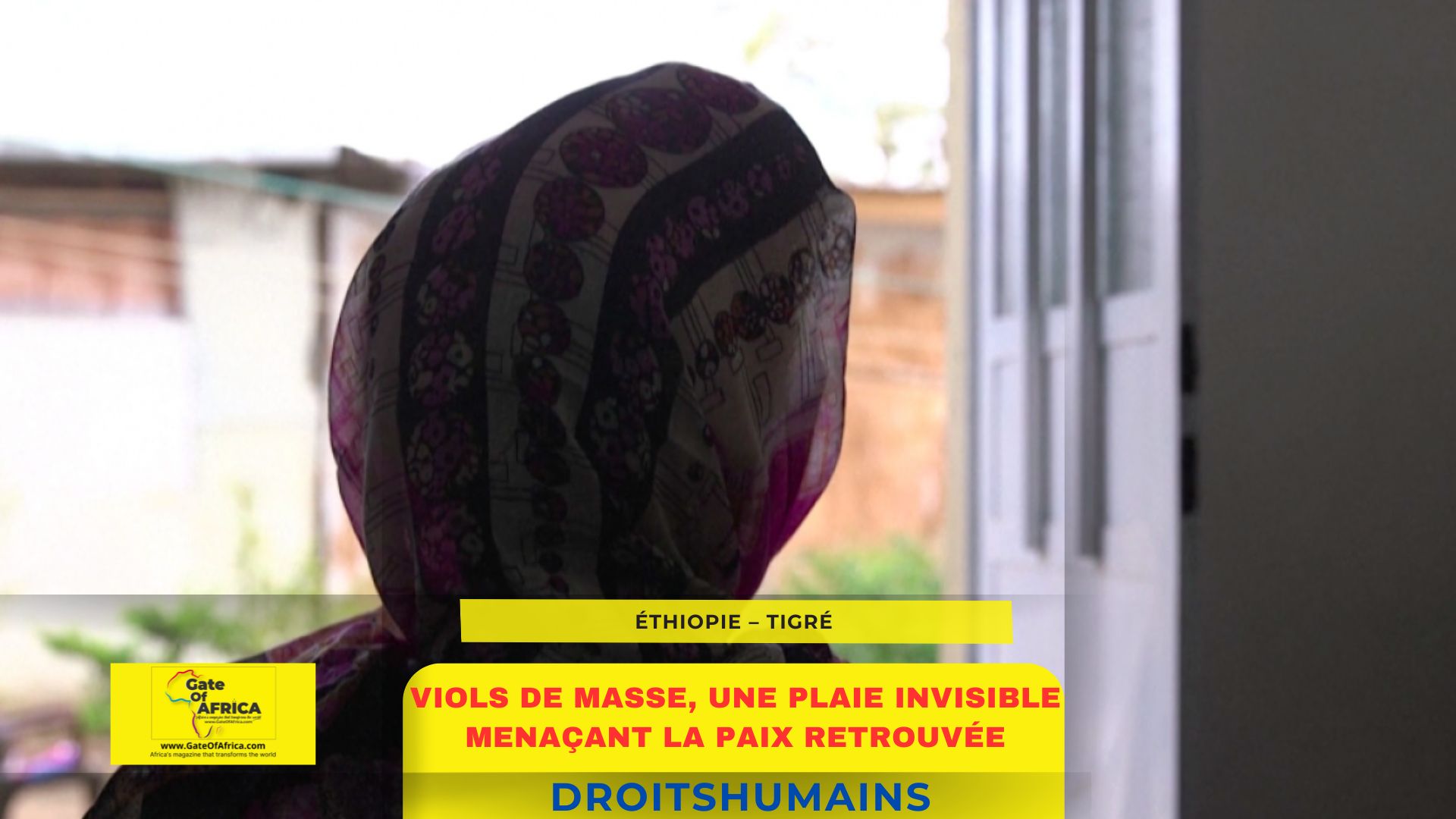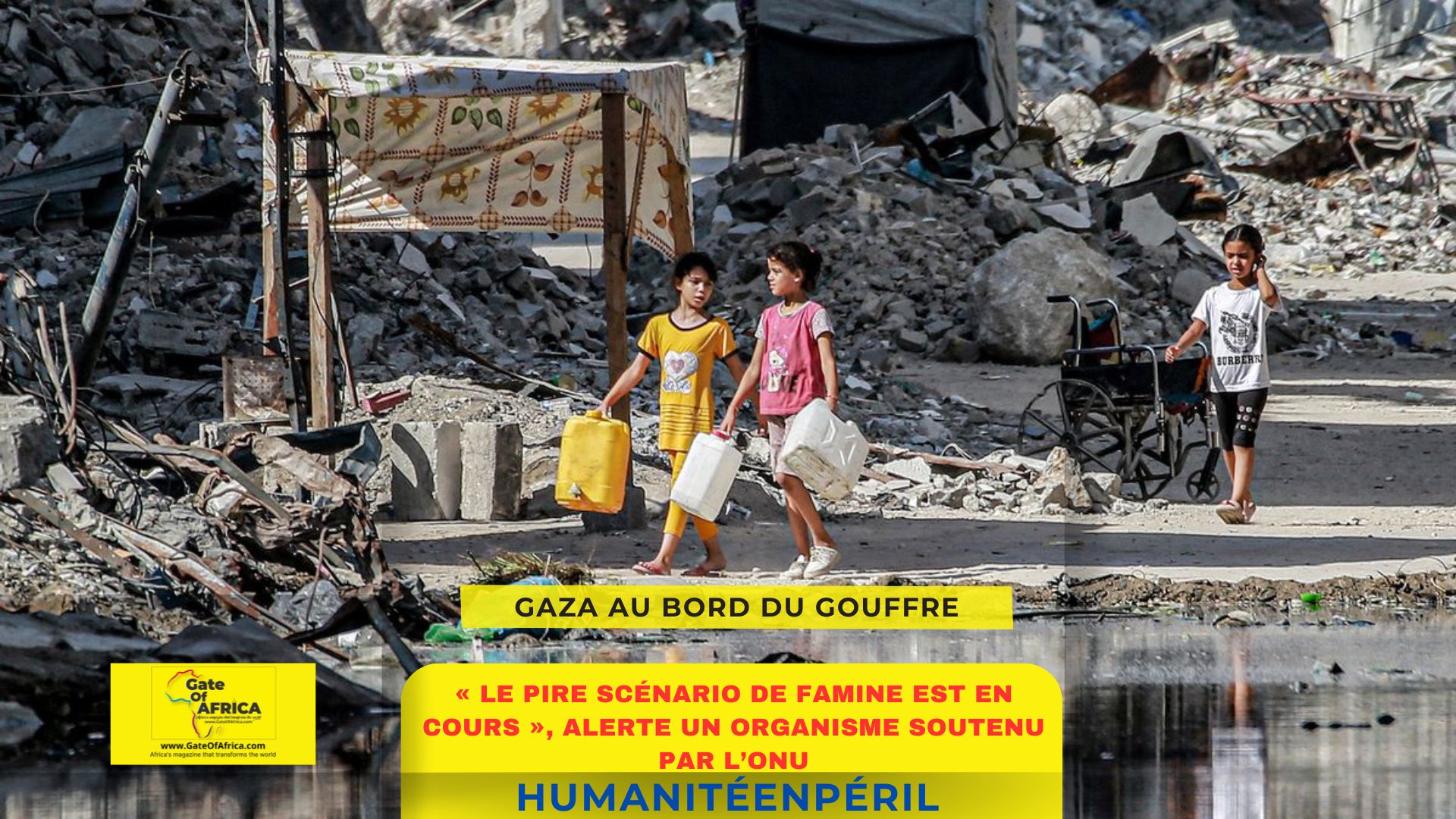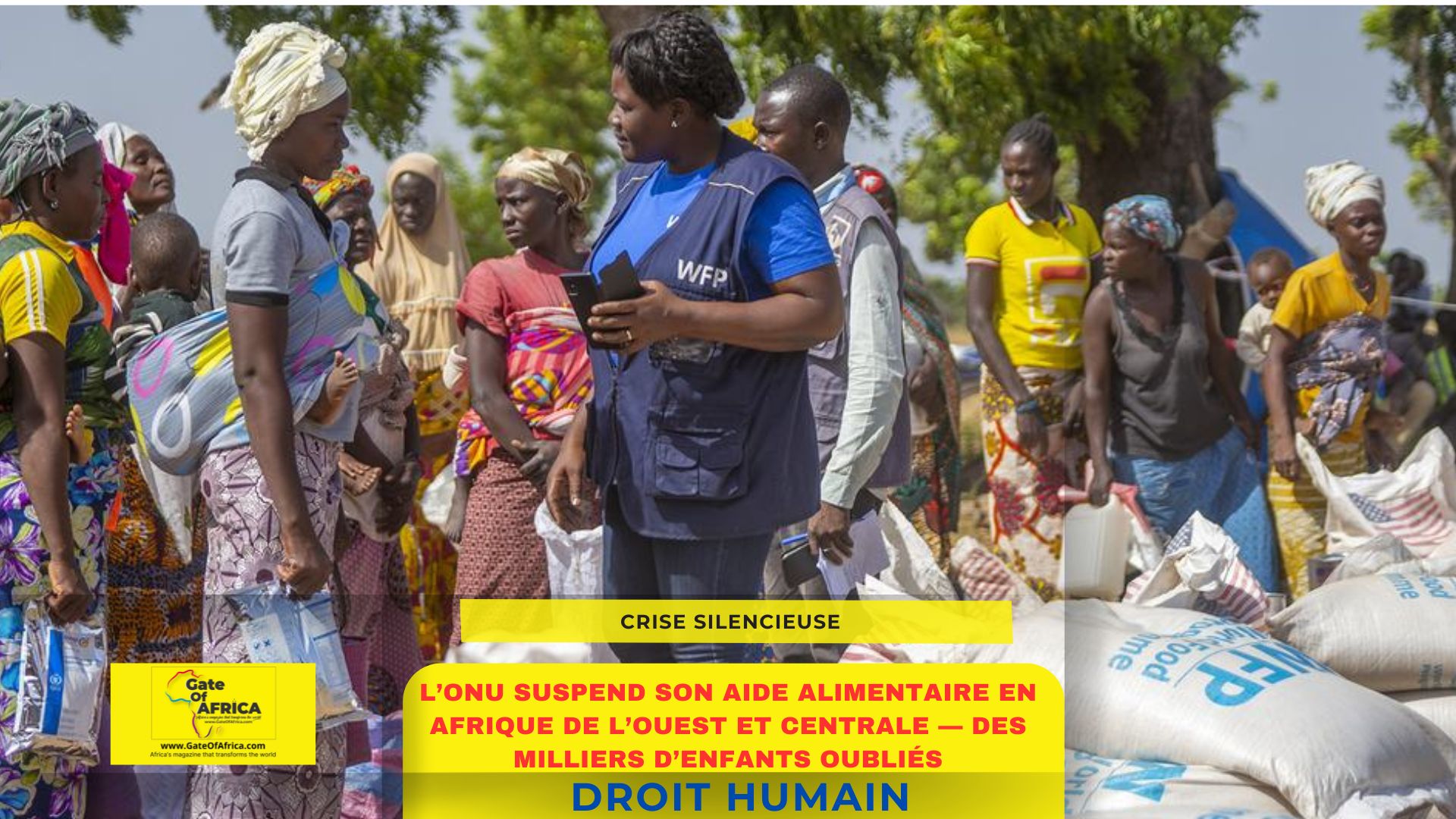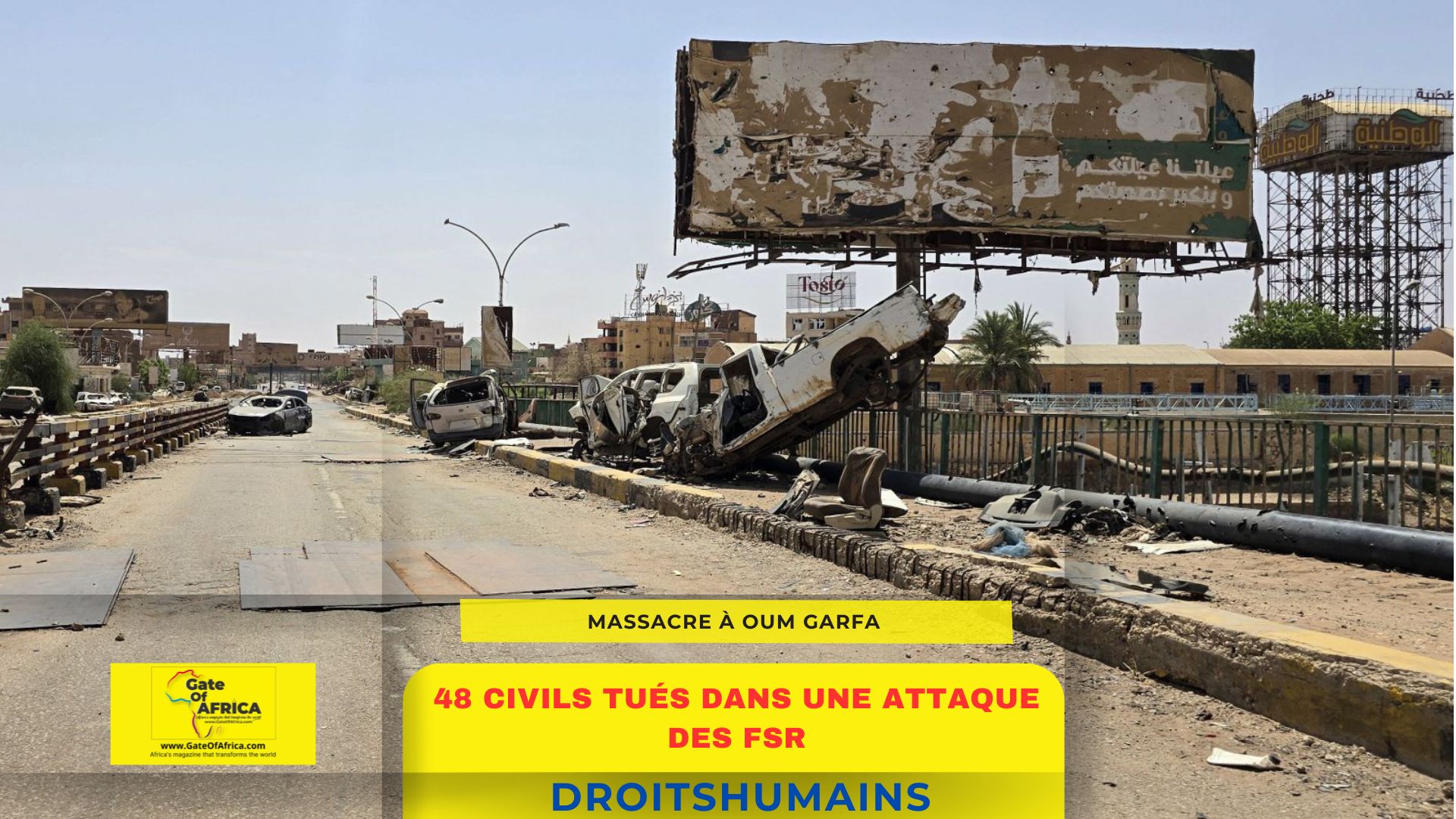Chapeau
Entre 2020 et 2022, la guerre du Tigré a laissé des cicatrices indélébiles. Des dizaines de milliers de vies se sont évanouies dans la tempête des combats. Mais dans l’ombre des explosions, une autre guerre se jouait : une offensive cruelle visant les corps des femmes. Selon l’ONU, plus de 120 000 femmes ont été victimes de viols systématiques et d’autres violences sexuelles. Deux ans après la fin des hostilités, le silence assourdissant des autorités étouffe la quête de justice et freine la reconstruction des survivantes.
Une guerre insidieuse contre les femmes Avec l’éclatement du conflit en novembre 2020, la violence sexuelle a émergé comme une arme de terreur.
« Les soldats nous ordonnaient de nous déshabiller, riant de notre humiliation. Ils nous ont violées, une à une, avant de nous abandonner nues dans la brousse », évoque une survivante.
Des centaines de témoignages, recueillis par des ONG et agences, révèlent des atrocités inqualifiables : viols collectifs, esclavage sexuel et mutilations génitales. Les présumés coupables ? Souvent des soldats éthiopiens, des forces érythréennes, et quelquefois, des milices amhara.
Des chiffres alarmants, une reconnaissance absente Ces 120 000 victimes, d’après l’UNFPA, ne sont qu’un chiffre d’une marée de souffrance ; les agressions continuent de s’épanouir dans l’oubli.
Malgré l’ampleur de ces crimes, les autorités fédérales et tigréennes ont échoué à instituer un plan d’action. Identifier les coupables et soutenir les survivantes semble un rêve suspendu. La Commission éthiopienne des droits de l’homme, bien que semi-indépendante, hésite à publier ses rapports. Pendant ce temps, les plaignantes subissent des pressions inévitables.
Des vies brisées, une reconstruction entravée Les survivantes portent un fardeau insupportable : blessures physiques et stigmates sournois. Répudiées et abandonnées, peu osent encore briser le silence.
« Je ne pourrai jamais avoir d’enfants. J’avais 19 ans quand tout a basculé. Ma famille ne me voit plus comme une femme », confie une victime dans un centre de Médecins Sans Frontières, au nord de Mekele.
Les établissements de santé, déjà ruines après la guerre, rendent les soins en santé mentale et reproductive presque inaccessibles.
Des blocages politiques persistants L’accord de paix signé à Pretoria en novembre 2022 a mis fin aux combats… mais a oublié les souffrances. Aucune clause ne fait allusion aux violences sexuelles.
Le gouvernement d’Abiy Ahmed privilégie une justice transitionnelle, éthiopienne à souhait. Les mécanismes internationaux sont mis de côté — une posture jugée vouée à l’échec par les défenseurs des droits humains.
« Parler de réconciliation sans justice pour les femmes est un non-sens moral et politique », souligne un représentant de Human Rights Watch.
Sources vérifiées
Rapports d’Amnesty International (2021, 2022)
Études de l’ONU et du UNFPA sur les violences sexuelles en zone de conflit
Témoignages de survivantes recueillis par la BBC et Reuters
Déclarations de la Commission éthiopienne des droits de l’homme (CEDH)
Témoignage anonyme « Les soldats prétendaient que nous étions leurs ennemies, qu’ils avaient le droit de nous “punir” avec leurs corps. J’ai perdu toute ma famille ; je vis avec cette douleur chaque jour. »
Conclusion
Deux ans après l’interruption des combats, le Tigré demeure un territoire de silence pour les femmes victimes de violences sexuelles. La paix n’est qu’un mirage sans reconnaissance, réparation et justice. La lutte pour la dignité a juste commencé ; la communauté internationale doit résonner davantage pour faire entendre ces voix étouffées.
Djayns – Gate Of Africa Magazine
Retrouvez nos enquêtes et analyses sur : Gate Of Africa Magazine – Facebook
#Tigré #Éthiopie #ViolencesSexuelles #CrimesDeGuerre #JusticePourLesFemmes #DroitsHumains #ConflitArmé #Afrique #GateOfAfricaMagazine